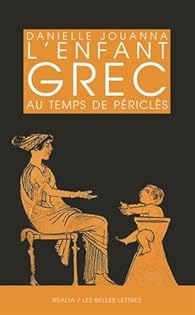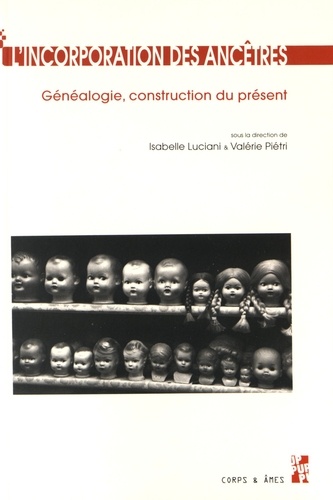Pour la version PDF : cliquez ici
Des abeilles et des hommes
À propos de Cinéma et bioéthique, être plus ou moins un sujet, de Marc Rosmini,
Aix-en-Provence, Rouge Profond, 2019, 224 p.
Le nouveau livre de Marc Rosmini est le
troisième qu’il consacre au cinéma, après Road
Movies (2012) et Méditations
westernosophiques (2015)[1].
L’occasion lui est offerte d’approfondir les relations entre la philosophie et
le cinéma en général, et plus particulièrement entre ce souci intellectuel de
la totalité de l’expérience que constitue la connaissance philosophique et la
pratique à la fois abstraite et concrète, réfléchie et dramatique, que
représente la production d’un événement cinématographique. Comme toujours, Marc
Rosmini ne sépare pas l’esthétique de l’éthique, la dimension individuelle du
créateur d’une œuvre et la réalité collective qui lui confère l’existence
véritable – en la consacrant à la fois comme une œuvre d’art (un chef-d’œuvre,
un classique ou un film-culte) et comme le sommet d’une inquiétude morale.
Le lecteur des œuvres précédentes n’aura
aucun mal à établir des relations de résonance entre les films de route et le
western, deux genres qui ne sont pas sans chevauchements ni « filiations
inversées »[2]. Quant
aux Méditations westernosophiques,
elles ne pouvaient manquer d’interroger la nature de l’acte moral (est-il pur
ou impur ?), les frontières labiles entre le soi et l’autre, entre le réel
et l’illusion, fissures et turbulences qu’on retrouve dans le devenir sporadique
du sujet affecté par les biotechnologies, au sein d’une société qui lui propose
plus de doutes et d’apories que de clés ou de solutions à ses difficultés nouvelles.
On sait que l’invention de solutions à des problèmes inédits est appelée
d’ordinaire intelligence, et que ne
pouvant compter ni sur les instincts de
la nature ni sur les catégories traditionnelles de la culture, il nous faudra,
cinéspectateurs perplexes, trouver à plusieurs des essais de réponse aux
esquisses dramatiques que propose chaque film[3].
La réflexion bioéthique devient le moment
subjectif des leçons objectives du
western et du film de route : la frontière mouvante, le désert amorphe, la
contrée sauvage toujours mal apprivoisée, le crépuscule, la fragilité des
pistes, l’errance de ceux qui ont perdu la foi, les routes sans fin, tous ces
signes extérieurs sont passés à l’intérieur d’une conscience qui ne peut plus
procéder à une paisible synthèse de ces états d’âme pour savoir qui elle est. Cinéma et bioéthique est donc la
réflexion, dans le milieu de l’esprit, des apories du désert et de la
route : non que l’esprit souverain y surgisse pour opérer la synthèse
triomphale du divers, bien au contraire. À partir de quel a priori le pourrait-il ? Avec le cinéma, nous apprenons à
renoncer à une forme d’intimidation transcendantale : à condition
d’accepter de voir ce que propose un film, d’en faire une authentique
expérience (ce qui peut prendre un certain temps) en en mesurant la riche
perplexité et la courageuse indécision.
Mais au-delà des constantes, thématiques
et problématiques des trois opus de Marc Rosmini sur le cinéma, et par-delà
l’unité d’une réflexion qui se reprend autour de ces mêmes inquiétudes qui
forment l’étoffe d’une passion de voir et d’une exigence de penser, la
différence entre les deux premiers livres et celui-ci, qui certes est de degré
plus que de nature, reste cependant qu’il ne s’agit plus d’étudier un genre (le
road movie ou le western) pour
déterminer la portée classificatoire d’une catégorie, mais de rassembler une
trentaine de films très différents qui présentent des caractères communs
relatifs à un problème, celui posé
par la réalité bioéthique des sociétés contemporaines. La philosophie vit de
problèmes plus que de repères ou de leçons, et sa rencontre avec un cinéma qui
ne recule pas devant la question et a parfois suffisamment de maturité pour
s’abstenir de juger les fragments de vie qu’il expose à la lumière de son art,
ne peut manquer d’être fructueuse.
Faire ainsi un sort à certaines idées de cinéma qui s’emparent de
situations concrètes mais complexes pour les schématiser sans les simplifier,
c’est les proposer, comme un défi, à l’intelligence collective. Celle-ci ne pourra
compter que sur les vertus de son activité à se décentrer pour penser la
personne au-delà des partialités individuelles. Les idées de cinéma, en
particulier, et en général, les idées dans la philosophie moderne, ne sont pas
des médiations ambiguës mais des possibilités de perception : l’écran ne
fait pas écran ; il ne s’intercale pas entre un sens obvie et un
spectateur attentif pour montrer tout en dissimulant, ou pour voiler en
révélant. Les idées de cinéma sont des conditions d’intelligibilité, ce dont
nous devons partir pour nous représenter le monde, pouvoir le comprendre et
espérer agir sur lui. Disons encore un mot du corpus avant de revenir sur le
sens de cette méthode.
La question de l’homogénéité du corpus des
28 films retenus est la même que celle du principe qui a présidé à sa
constitution : la diversité des genres (science-fiction, horreur, comédie,
drame, etc.) se focalise autour d’une époque (qui va de 1990 à 2017) après des
films précurseurs (six de 1970 à 1986) : le film le plus ancien, THX 1138 de George Lucas, sort sur les
écrans en 1970, l’année de naissance du mot bioéthique
créé par Van R. Potter pour désigner « la nouvelle discipline qui combine
connaissance biologique et connaissance des systèmes de valeurs
humaines ». Mais, si on trace une ligne de séparation à partir de l’année
2000, les deux tiers des films se situent au-delà de ce repère. Cette partition
est évidemment significative d’une période contemporaine au climax de la crise
sociale et culturelle des années soixante, portée à son paroxysme par la chute
du mur de Berlin, la crise de l’historicité, la fin des grands récits et des
promesses de salut, sans oublier le repli dans le silence des grandes figures
de l’autorité intellectuelle[4].
Les films expriment une nouvelle conception du monde, qui ne croit plus au
politique, se méfie des justifications juridiques, et apprend à faire le deuil
des certitudes morales, des illusions sociales et des promesses du futur.
L’espérance utopique a cédé la place à l’exigence d’une éthique du présent, aux
enjeux inédits et aux conséquences imprévisibles. Il est vrai que les films
insistent davantage sur les problèmes qu’ils ne proposent de réelles solutions :
le silence du Souverain, la voix blanche des juges, la cacophonie familiale,
les désillusions collectives (du groupe professionnel ou de l’équipe sportive)
soulignent le caractère à la fois impérieux et énigmatique des événements qui
bousculent les codes habituels de la normalité traditionnelle. Il faut inventer
de nouvelles conceptualisations pour un monde devenu autre, désorienté, sorti
de ses gonds, étranger aux idéaux émancipateurs pré-établis, sans qu’on puisse
pour autant se satisfaire d’une vie quotidienne où l’acquisition des
marchandises consume les projets sitôt formulés.
Mais ce qui importe le plus en ce qui
concerne ce corpus, outre son hétérogénéité générique et sa coloration
d’époque, c’est que l’ensemble des films entretient une relation privilégiée avec
le problème de la subjectivité qui est consciemment valorisée en regard de la
relation que le titre du livre établit avec les biotechnologies. D’où une
lecture de films, comme le précise d’emblée l’auteur, sans rapport avec une
dimension bioéthique proprement dite mais concernée par une bioéthique au sens large (élargissement qui ne
convaincra sans doute pas tous les lecteurs de l’ouvrage). Le choix est
finalement plus « humaniste » et classique qu’il n’y paraît puisque
les technologies du vivant y sont toujours débordées par la question de la
dignité humaine que seuls sont appelés à résoudre (s’ils le peuvent) des êtres
humains contraints de réfléchir, à l’aide de leurs jugements fragiles, sur ce
que c’est qu’être ou devenir un sujet, par-delà les codes sociaux, les machines
et les experts. Question parfois paroxystique quand il s’agit de
situations-limites comme la mort, mais question toujours présente derrière les
tuyauteries et les graphiques, les appareillages médicaux et les chicanes
juridiques. Il y a ainsi des films plutôt excentrés par rapport à la topique
bioéthique (Mia Madre, In the family), d’autres plus proches
sans être pour autant fondamentaux (Get
out) et d’autres qui occupent le cœur même du sujet, souvent de manière plus
spectaculaire que significative (Ces
Garçons qui venaient du Brésil). Le film-paradigme de la problématique du
livre est sans nul doute Un conte de Noël,
sur lequel je reviendrai brièvement. Dans cette œuvre, la question du
« greffon » de moelle osseuse, compatible mais peut-être hostile, ne
prend sens que dans le contexte de la période de Noël, moment de la
nativité-naissance s’il en est, durant laquelle les « hôtes »
invitent leurs enfants (eux aussi « hôtes ») à passer quelques jours
en famille pour se prononcer sur le choix d’un donneur compatible. Toute
l’ambiguïté de l’hôte, ami et ennemi (hostis
en latin) s’y déploie, en un sens médical (greffon, donneur compatible,
hostilité éventuelle par inflammation) et un sens familial et symbolique, qui
s’avère d’une complexité vertigineuse et crépusculaire. Le sens de l’existence
devient ici une question quasiment insoluble en termes de signification puisque
la temporalité de la vie et de la mort, ainsi que la linéarité de la filiation, ont été
inversées dès le début du film. La fatalité biologique y est retournée comme un
gant au nom d’une assomption
métaphysique des événements dramatiques : la mort d’un enfant est
la fondation d’une paternité et le frère qui n’a pu sauver son frère victime
d’une maladie génétique transmise par sa mère, sauvera la mère qu’il déteste.
Cette reprise par l’humain des apories de la nature et des limites de la
technique se retrouvera, peut-être d’une manière moins radicale, mais tout
aussi révélatrice du souci philosophique de Marc Rosmini, dans d’autres films.
Mais que ce soit dans Get out ou dans
Ces garçons qui venaient du Brésil, Marc
Rosmini comprend bien qu’il ne s’agit pas de remettre en cause les techniques
elles-mêmes, comme le font trop souvent des philosophes paresseusement
technophobes et catastrophistes (au nom du çavapétisme)
qui atteignent leur « point Godwin » à une vitesse supérieure à celle
de leur syllogisme. Dans ces deux derniers films notamment, la question est
moins de savoir si la transplantation cérébrale ou le clonage reproductif sont
des techniques coupables que d’interroger les aspirations de ceux qui en
feraient usage. La transplantation des cerveaux et le clonage sont dans ces
deux films de simples outils au service d’un même désir d’éternité et d’un refus
criminel de l’histoire et de l’altérité, la volonté folle d’éterniser une image
de soi impérieuse et suprématiste[5].
La technique n’est pas en cause : axiologiquement neutre, elle ne vaut que
ce que vaut la libido des nouveaux docteurs si peu doctes, les Frankenstein ou les
Folamour, qui y voient le raccourci technologique de la réalisation de leurs délires.
C’est donc du côté des fantasmes et des représentations du désir qu’il faut
enquêter, bref s’appuyer sur les vertus du cinéma pour retravailler notre sens
commun, cette faculté de rassembler intelligemment les sensations que les
philosophes ont toujours considérée comme étant le centre de ce qu’on appelle imagination. Marc Rosmini le fait avec
rigueur sans renoncer à sa position d’humilité : le rythme des
techno-biologies n’est pas celui d’une lente évolution qui nous transforme,
mais d’une brutale mutation qui nous bouscule, nous impacte comme on dit aujourd’hui, et parfois nous sidère. Il
devient essentiel, grâce au cinéma, en laissant le film nous traverser et nous
transformer (ce que les italiens appellent « faire le spectateur – fare il spetattore ») de promouvoir
des questionnements capables d’être argumentés et délibérés par des sujets
potentiels pour se prononcer éthiquement dans un espace démocratique, car
« déléguer la réflexion éthique à des experts »
est le prix à payer à une abdication irresponsable de notre autonomie et à
l’abandon coupable de la concertation[6].
Pour ce faire, l’auteur propose de
distinguer trois plans : tout d’abord celui du vécu, de « l’existence
réelle, concrète, incarnée, celle de la vie et de la mort de chacun d’entre
nous » ; puis celui « de la pensée, des principes, des normes,
de la philosophie – et donc de l’abstraction »[7] :
entre ces deux limites s’ouvre l’espace médian du cinéma, celui où
l’imagination montre des situations problématiques, pas simplement vécues ni
simplement pensées, mais, dirais-je, schématisées.
Road Movies avait prévenu son
lecteur : « l’approche des films est toujours menacée, d’un côté par
un relativisme mou et démagogique, et de l’autre par un élitisme méprisant et
autoritaire »[8]. Cinéma et bioéthique s’installe entre
ces deux écueils : ce n’est pas n’importe quel vécu que le cinéma
rapporte, que le scénario élit (l’histoire y devient récit), que le montage
structure, que la lumière inonde ou rase, que la musique (s’il y en a)
interprète ; mais le film n’est pas non plus le support d’un message,
d’une thèse, le tableau noir d’une démonstration figurée. L’imagination
cinématographique n’est ni la servante de l’entendement ni la plaque
révélatrice de la vie émotive. Elle joue un rôle actif dans la dramatisation
des situations et des problèmes : elle est fantaisie, feinte et fantasme,
mais aussi figuration, voulant transcender à la fois les abstractions de
l’intelligence et la confusion des sentiments. Ayant son siège dans le sens
commun, elle a toujours une vocation collective : elle incarne les normes
et « artialise » le vécu (un bon scénario est un vécu devenu paysage)
dans des situations qui déroutent nos jugements en projetant une incertitude au
lieu-dit de l’évidence. Les dogmes se brouillent et les repères
vacillent : à l’épreuve du concret, « les identités sont instables, à
l’image du réel qui est insaisissable »[9].
Les films sont des objets hybrides dont l’effet de représentation intensifie
l’existence tout en la faisant sortir de ses gonds.
Cette zone médiane, où d’une certaine
manière l’imagination prend le pouvoir, n’est donc pas l’espace d’un banal
compromis. Le philosophe Francis Bacon, dans son Novum Organum, avait renvoyé dos à dos les empiriques qui se
contentent de leurs impressions en amassant des données comme travaillent les
fourmis, et les dogmatiques qui inventent le monde à partir de leur seul esprit
comme les araignées extraient d’elles-mêmes le fil qui tisse leur toile. Ni
fourmis, ni araignées, les vrais savants étaient pour lui des abeilles,
organisées et industrieuses, faisant leur miel des fleurs ici et là butinées[10].
Mais si Marc Rosmini dénonce lui aussi les dangers d’un empirisme sans idées et
les périls d’un dogmatisme sans terrain, il ne préconise pas pour autant le
travail des abeilles, qui a quelque chose de superficiel et d’aléatoire. La
lecture de Nietzsche ou la vision du film d’Arnauld Desplechin permettent à
notre fantaisie d’aller au-delà de ce triangle savant – les concrets, les
abstraits et les positivistes – pour poser la question d’une connaissance des
choses qui n’aurait pas fait l’impasse sur la connaissance de soi[11].
C’est de cette connaissance dont il est question dans cette zone intermédiaire
où le cinéma simule et stimule notre activité intellectuelle. Ni fourmis, ni
araignées, ni abeilles – mais des hommes en quête de leur autonomie et de leur
dignité. Aussi les salles obscures ne sont-elles pas l’antithèse des pensées
claires et distinctes. Le cinéma n’est pas la nuit de l’esprit. Il occupe la
zone médiane où les idées s’incarnent et où le vécu se réfléchit, le champ
clair-obscur où la réalité devient problème et vie, où la simple pensée prend
corps en devenant question et mouvement. Il est aussi le lieu social où les
individus assument le risque de devenir des personnes.
Passons maintenant au fond lui-même tel
que l’ouvrage le développe en quatre parties (la procréation, le don d’organes,
la mutation et la mort). Les vingt-huit lectures ont l’ambition de présenter,
de la naissance à la mort, les questions du clonage, des diagnostics prénataux
et préimplantatoires, de l’eugénisme, de la gestation pour autrui, de
l’insémination artificielle, du don d’organes, de la neuro-augmentation, de
l’éthique soignante, de l’euthanasie, des rapports du cerveau et de la
conscience, de l’esprit et de la chair et de toute une série d’interrogations
fondamentales que je ne peux ici que suggérer, préférant renvoyer aux belles analyses
des films qui les expriment. Les lecteurs trouveront évidemment à dire et à
redire, pouvant prolonger ces réflexions, les conforter, les confirmer, ou
alors les amender, les compléter, les critiquer, etc. Inutile de le faire ici
puisque c’est l’objectif même de Marc Rosmini que de susciter cette active
délibération commune et ce dialogue général seuls aptes à étayer les linéaments
d’un choix réfléchi. Contentons-nous, en suivant l’esprit de l’ouvrage,
d’indiquer trois de ces grands axes : ce qui surgit sur l’écran, ce qui
traverse le spectateur, ce qui interroge les cinéspectateurs – ou ce qu’on
pourrait appeler l’émotion filmique, l’expérience cinématographique et la
discussion démocratique.
La question de ce qui doit être montré ou
pas, est première tant du point vue de l’intention de l’auteur que de
l’expérience du spectateur[12].
Beaucoup de films insistent sur cette dimension première, affective et
émotionnelle, comme l’indique d’emblée Marc Rosmini. Au point que l’écran comme
médiation puisse aller jusqu’à faire écran (ou obstacle) aux deux autres
dimensions du film que sont son expérience et son interprétation. Beaucoup de
films énoncent en dénonçant, montrent en faisant peur et choisissent une
matrice narrative connue, celle de la dystopie et de la fuite (Get Out ou THX 1138), du déséquilibre extérieur et de la résistance (Bienvenue à Gattaca)[13].
Beaucoup de films ainsi construits déposent dans l’esprit du public, à propos
du clonage reproductif ou de la robotisation de l’existence, une thématique de
l’effroi, un jeu émotif qui oriente déjà la réflexion. Il faut rappeler que montrer et monstration sont des termes qui renvoient aussi bien à un contexte
logique (la démonstration) qu’à un contexte tératologique (le monstre), et la
combinaison des deux registres peut atteindre les sommets de l’épouvante
(cloner quatre-vingt quatorze génotypes d’Hitler et organiser les quatre-vingt
quatorze milieux sociaux favorables à l’éclosion d’une personnalité
dictatoriale, en recourant aux meurtres planifiés, fait froid dans le
dos pour qui découvre le scénario de Ces
Garçons qui venaient du Brésil). Mais montrer, selon l’étymologie, c’est
aussi prévenir d’un danger, annoncer au sein même de l’humain la potentialité
d’une inhumanité inédite et criminelle : Bienvenue à Gattaca est une dystopie assez classique qui met en
scène la mort du monde sous la forme d’une uniformité des individus entièrement
déterminés par leur ADN. Montrer aime
bien s’exagérer en monstre :
mais n’est-il pas inquiétant de constater la banalisation et la diffusion
acritique de certaines expressions comme « c’est dans son ADN
de... » ?
Notre second axe suit la recommandation de
Marc Rosmini d’éviter de soumettre l’analyse du film et du problème éthique
qu’il repère au simple pathos. L’expérience du spectateur est plus distanciée.
Sa disponibilité le rend conscient de ce que le film nous a fait (rire,
pleurer, peur, dormir), à sa résonance en nous en tant que cinéspectateur.
Premier moment d’une réflexion, celle d’une homogénéité ontologique bien malmenée
par les questions bioéthiques des films en question. Inutile d’insister,
l’auteur le faisant avec brio et lucidité en diversifiant les approches,
changeant d’angle d’attaque (la résistance de la chair, la limite de
l’humain, la précarité de la conscience, etc.) et passionnant toujours son
lecteur par cette double maîtrise d’un cinéma qu’il aime et d’une philosophie
qu’il entend promouvoir. L’expérience de ce niveau est celle d’un éclatement du
sujet, d’une fragmentation de soi, d’une opacification du principe
d’individuation, d’une remise en question du principe de la substance, d’une
polysémie troublante des conceptions de la dignité, de la liberté, du choix
qu’un être peut encore faire ou non de l’ensemble de sa vie pour lui donner la
forme d’une destinée ou la laisser se perdre dans la fluidité du réel.
Si « un film est un être autonome,
avec un acte de naissance et une carte d’identité »[14],
il n’en va pas même des abstractions et de leur façon, juridique ou politique,
de définir des êtres humains en les rangeant dans des catégories. Ainsi les
personnages de Starbuck sont-ils des
acteurs pirandelliens, en quête d’auteur : individus isolés, délaissés ou
incomplets, ils demandent à devenir des personnes, c’est-à-dire des êtres
humains animés de sentiments réciproques, mais aussi des citoyens dont le rôle
(c’est le sens étymologique du mot « personne ») soit reconnu par le
droit et l’État. Leur recherche correspond à ce long et passionnant travail sur
soi que Marc Rosmini appelle « subjectivation », façonnement à plusieurs d’un sujet qui n’est pas donné,
mais à construire, qui n’est plus une entité complète mais un point de fuite,
un horizon et un défi : « Devenir soi-même constitue un processus
sans doute impossible à mener à son terme ; on n’a jamais fini de se
construire en tant que sujet. Sur ce chemin aléatoire et fragile, certains des
films que nous rencontrons constituent des étapes majeures du travail, étrange
et passionnant, de subjectivation »[15].
Günther Anders prônait « une façon de
philosopher qui prend pour objet la situation actuelle, c’est-à-dire des
fragments caractéristiques de notre monde actuel »[16].
Marc Rosmini analyse moins les films en eux-mêmes qu’un quelque chose
d’inquiétant et d’opaque en chacun d’entre eux. Son interprétation a pour dessein
de diminuer la distance qui sépare chacun de lui-même. Le cinéma offre de
riches occasions d’apprivoiser cette étrangeté et de rendre les humains moins
lointains les uns pour les autres, en favorisant les conditions d’une
connaissance de soi et d’une synergie des subjectivités aptes à délibérer
« de la coexistence de leurs libertés dans le cadre d’institutions
toujours perfectibles »[17].
Le sujet est en question(s), parfois en
vrac : mais ces interrogations, nous devons les ressaisir pour que le
reflux des certitudes et le retrait ontologique ne soient pas les premiers
symptômes d’un effondrement général. Ce livre est ainsi toujours soucieux de
savoir où est le sujet, ce qu’il en est de sa dignité, de sa liberté, de sa
conscience. Il a le courage de ses sentiments : il ne lâche pas
l’essentiel tout en sachant que notre futur n’est plus synonyme de progrès et
que nos inquiétudes existentielles ne sont pas apaisées par la profusion des
gadgets et le ludisme des mondes virtuels. Abandonner la question du fondement
est le moyen le plus sûr de laisser place aux fondamentalismes. Le sujet, la
dignité, la liberté, la décision ? Cinéma
et bioéthique y revient toujours. Que les rapports sociaux deviennent des
relations sociales, le livre en réitère l’impérieuse exigence. Marc Rosmini
prend ces questions au sérieux. Les problèmes ne sont pas des chimères :
« l’héritage que tu tiens de tes pères, disait Goethe, il te faut le
reconquérir ». Si le futur ne nous est plus promis, nous sommes condamnés
à le vouloir. Les morales dogmatiques et closes ne fonctionnent plus :
l’exigence éthique qui anime les vingt-huit lectures de l’ouvrage en est la
preuve indiscutable et la vérité inquiète.
Serons-nous capables, comme le héros de
Starbuck, de « dealer avec le chaos » pour y faire germer l’étoile
d’un nouveau cosmos ? Empédocle disait que l’univers alternait des phases
d’amour et des phases de haine : peut-être sommes-nous entre deux de ces
souffles essentiels ? Cinéma et
bioéthique fait partie de ces livres indispensables à tous ceux qui sont
conscients, pour paraphraser le titre d’un film célèbre, que, dans le monde qui
est devenu le nôtre, il est encore Minuit dans le jardin du bien et du mal.
Benoît Spinosa
[1] Road Movies, 227 fragments sur un genre introuvable et 38 photographies
de Bernard Plossu, Marseille, Images en Manœuvres Éditions, 2012. Pour les
références qui suivent, en abrégé, RM, suivi du numéro du fragment et de celui
de la page. Méditations westernosophiques,
Médiapop Éditions, 2015. En abrégé MW, suivi du numéro de page. Pour le présent
ouvrage, CB, suivi du numéro de page.
[2]
RM, 90, p. 71 ; MW, p. 204, note 15.
[3] Une conception de l’intelligence
plus noble et plus critique que la version quantitativiste et amorale qu’en
présente le film Limitless et que
Marc Rosmini critique avec des arguments très convaincants, CB, pp. 143-144.
[4] Cf. RM, 153, p. 106 :
« impossible donc de saisir le sens d’un film sans considérer son rapport
à l’Histoire en général : histoire politique, culturelle, sociale,
philosophique, religieuse, économique, etc. ». Pour le
« fractionnement axiologique » résultant de cette crise des grands
récits, voir la conclusion de CB, p. 215.
[5] Il est devenu courant, dans la
réflexion bioéthique contemporaine, d’opposer la figure de Prométhée, allégorie
de l’ivresse technicienne d’une maîtrise arrogante de la Nature, à la figure
d’Ulysse, symbole d’un art du discernement et d’une paradoxale mais essentielle
audace de la prudence. L’opposition paraît d’autant plus pertinente qu’Ulysse a
refusé l’immortalité offerte par Calypso pour assumer sa condition humaine.
[6] « Une telle délégation serait
infantilisante et dangereuse. L’hétéronomie l’est toujours », CB, p. 9.
[7] CB, p. 11.
[8] RM, 128, p. 91.
[9] RM, 112, p. 82. Ces topiques de
l’errance, de « la sortie de route », ce goût du détour qui affine
nos perceptions et ce syndrome du chardon vagabond (le tumbleweed) donnaient sens à l’idée de porosité de la frontière,
thème qu’on retrouve bien sûr dans les MW, p. 9, et ses « manières
singulières de questionner les évidences, de mettre en doute les certitudes, ou
encore d’interroger certains concepts ».
[10] Francis Bacon, Novum Organon (Le nouvel instrument), I,
§. 95 : « Ceux qui ont traité des sciences furent ou des empiriques
ou des dogmatiques. Les empiriques, à la manière des fourmis, ne font
qu’amasser et faire usage ; les rationnels, à la manière des araignées,
tissent des toiles à partir d’eux-mêmes. Mais l’abeille tient le juste
milieu : elle extrait la matière des fleurs des jardins et des champs,
mais cependant la transforme et l’assimile par une faculté qui lui est
propre : et le travail de la philosophie n’en est pas vraiment différent. »
[11] Il s’agit de l’Avant-propos à la Généalogie de la morale où Nietzsche
nous met en garde contre une science superficielle et contente
d’elle-même ; c’est ce texte qui est lu par Abel (Jean-Paul Roussillon)
dans Un conte de Noël. Se connaître
soi-même, c’est bien sûr l’injonction de Socrate, mais ici, les choses se
compliquent et les repères s’opacifient. Pour savoir qui nous sommes, nous ne
pourrons plus nous satisfaire d’une grande histoire qui relate notre origine
céleste, dont nous aurions à nous souvenir, et d’un salut incorporel qu’il nous
serait permis d’espérer. Cette mythologie de l’Origine et cette téléologique de
l’Absolu sont précisément pulvérisées par les innovations bioéthiques et les
mutations sociopolitiques de notre temps – ce qui discrédite toutes les figures
du Savant, de l’Expert, de l’Intellectuel ou du Manager qui ont tôt fait de
s’auto-légitimer quand les citoyens leur abandonnent le terrain de la
concertation et de la délibération démocratique. Sur cette construction
difficile et interminable de soi (qu’on appelle subjectivation), voir CB, conclusion, p. 219.
[12] Pour la géométrie variable du
champ du montrable, voir RM, 105, p. 77.
[13] C’est aussi le cas d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind, cf. CB, p. 147 et suivantes, où
l’esprit résiste à sa réduction matérialiste, persuadé que la pensée est quelque
chose d’autre que le cerveau : « Et ce qui se joue dans ce petit jeu
du chat et de la souris n’est peut-être rien de moins que la dignité de
l’homme », p. 150.
[14] RM, 65, p. 53.
[15] CB, conclusion, p. 219.
[16] Günther Anders, L’obsolescence de l’homme, sur l’âme à
l’époque de la deuxième révolution industrielle, (1956), Paris, Éditions
Ivréa, 2002, p. 22.
[17] CB, p. 155.